Latest News
Everything thats going on at Enfold is collected here
Hey there! We are Enfold and we make really beautiful and amazing stuff.
This can be used to describe what you do, how you do it, & who you do it for.
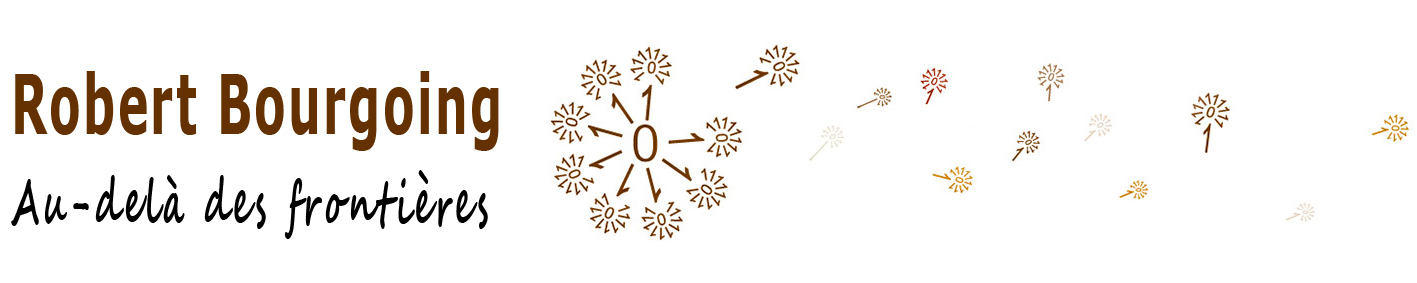





In Morocco, inspiring others with harm reduction work among injecting drug users
* This article was published in the Global Fund Observer (English – French), Aidspan‘s newsletter.
« There’s cannabis leaving Morocco and other drugs coming in from abroad, » explains Faoizia Bouzzitou, the educational coordinator for the Hasnouna Association to Support Drug Users (AHSUD in French).
In Tangier, AHSUD provides assistance to around 1,700 people who inject drugs, helping to dissuade them from sharing needles and engaging in other risky behaviors that put them at risk for HIV infection. HIV prevalence among the drug users of Tangier is just 0.4% — in stark contrast to Nador, a city 400 km to the east that launched its harm reduction work a few years later, where HIV prevalence among drug users is above 20%. The divergent figures contribute to a national estimate of 10% sero-positivity among injecting drug users.
HIV prevalence among the drug users of Tangier is just 0.4% — in stark contrast to Nador, a city 400 km to the east that launched its harm reduction work a few years later, where HIV prevalence among drug users is above 20%. The divergent figures contribute to a national estimate of 10% sero-positivity among injecting drug users.
Such harm reduction programming is unique to Arab countries but has demonstrated results that show it can, and should, be replicated.
AHSUD began its work in 2007 with a bio-behavioral survey and a mapping of the injection sites in Tangier, says Bouzzitoun. « We needed to know who we were talking to, and the extent of the problem. You need an evidence base before you talk to decision-makers. »
These data were also the basis for AHSUD’s successful application for Global Fund support, to purchase injection kits to stock a mobile unit: a modest van into which four staffers would climb every day and prowl the squats and hidden spots where drug users would converge to get their fixes.
« We started downtown, in the M’sallah quarter, where most of the heroin users stay. They were shooting up in front of people’s houses, leaving their syringes where kids could play with them. Some young girls were even using the syringes to give henna tattoos, » recalls Bouzzitoun. « So part of the early effort was to work with drug users to change their behavior. We gave them single-use, sterile needles. We taught them about the risks of infection, and other risks like TB, or HIV or Hepatitis C. And we showed them how to shoot up in the least risky way, and avoid overdose and how to figure out an alternative when they don’t have works to fix. We are trying to point them towards health centers. »
It is there that the association finds some of its biggest challenges, confronting the stigmatization of injecting drug use. Be it by health professionals, including doctors and pharmacists, police, or the general public, they are finding it a painstaking and slow process to change people’s minds. With door-to-door campaigns, field teams gently demonstrate the importance of harm reduction to Tangier’s citizenry.
« It’s because drug users are someone’s sons, someone’s daughters, » says Bouzzitoun, that it boils down to a simple choice: « do you want them to be able to inject safely, with a chance to get off the drugs, or do we want them to be exposed to Hepatitis C, to HIV, and to risk spreading these illnesses to society? »
Morocco’s journey to realizing the benefits of harm reduction programming has been a long and slow one. In 2010, opioid substitution therapy with methadone was launched in Tangier, Rabat and Casablanca: another program that received funding from the Global Fund as well as the Ministry of Health. And while methadone is no silver bullet, it helps reduce the risk of disease simply because it isn’t consumed intravenously. « So for 48 hours, a drug user can work, or shower, or eat — basically functioning like a regular person, » says Bouzzitoun.
The light at the end of heroin’s tunnel
Today, by broad consensus, AHSUD’s work is bearing fruit. « People we interviewed [for this documentary] say that it is not like it was before; there are fewer users, fewer drug injectors, less crime and less theft, » Bouzzitoun says proudly.
Also evolving is the mentality and attitudes of those who operate in the drug users’ orbit — specifically the police. « Now when a drug user is arrested, we get notified automatically by the police, who ask us to come and see if he needs treatment, » she says.
Risky behavior among drug users is also on the wane. Almost all of the injecting drug users supported by AHSUD use the kits of works they are given — syringe, spoon, filter, cotton and sterile water — and regularly participate in needle exchange. Among them are 400 people enrolled in a methadone program at the Medical Psychological Center next door.
These measures have really made the difference in helping bring down the HIV prevalence in Tangier’s drug-taking community. Also a contributing factor, said Bouzzitoun, is the HIV testing that around 80% of the people in the program have undergone. « We’ve done regular testing twice a week, every week, since 2008, » she says.
Now that the Tangier program has demonstrated such positive results, it was only natural that the program be extended to other major cities, beginning with Tetouan in 2009 and now Nador, Casablanca and Rabat.
Even the methadone program, despite its excellent results that allow more than two-thirds of participants to return to a regular life once they’ve kicked their habits, is coming up short, not able to meet the needs. In Tangier alone the waiting list is more than 900-strong.
« Most users want to get off the drugs », AHSUD says, but there aren’t enough services available to them in the region: not enough treatment, not enough staff and not enough options within the health system to meet demand. The Medical Psychological Center, which works alongside AHSUD, must oversee the methadone treatment of 350 people and is not accepting new clients.
Tangier, MENA’s harm reduction laboratory
The first country in the Middle East and North Africa to introduce both harm reduction and methadone programs, Morocco is now sharing its experience through a training center also run by AHSUD in Tangier.
They exhort the need for an evidence base, and provide guidance on how to forecast and plan to ensure that donors see the possibility for results. But mostly they plead for interlocutors to remember that people who inject drugs are just that: people. « We are trying to teach people how to approach users, how to talk to them and earn their trust, » says Bouzzitoun. « Because that is the only way you can reach them. »
Read this article in French. Lire l’article en français.
L’expérience du Maroc dans la prévention du VIH auprès des héroïnomanes inspire d’autres pays
*Cet article a été publié en français et en anglais dans
l’Observateur du Fonds Mondial, la lettre d’information d’Aidspan
« Il y a le cannabis qui sort du Maroc et d’autres drogues qui entrent de l’étranger », explique Faoizia Bouzzitoun, Coordinatrice pédagogique de l’Association Hasnouna de Soutien aux Usagers de Drogues (AHSUD). A Tanger, cette association vient en aide à 1700 usagers de drogues injectables (UDI) pour prévenir notamment la transmission du VIH par des seringues infectées.
Son programme de réduction des risques, unique en son genre dans les pays arabes, a réussi à limiter la séropositivité parmi les UDI à 0,4%. En comparaison, Nador, qui a commencé le sien bien après Tanger, compte plus de 20% d’injecteurs séropositifs (pour une moyenne nationale d’un peu plus de 10%).
En comparaison, Nador, qui a commencé le sien bien après Tanger, compte plus de 20% d’injecteurs séropositifs (pour une moyenne nationale d’un peu plus de 10%).
Le travail de l’AHSUD débute en 2007 par une enquête bio-comportementale suivie d’une cartographie des sites de shoot, raconte F. Bouzzitoun. « Il faut d’abord savoir à qui on s’adresse, et quelle est l’ampleur du problème. Il faut une base de connaissances avant d’aller voir les décideurs. » Avec ces informations, la nouvelle association obtient le financement du Fonds mondial pour acheter le matériel d’injection et démarrer avec l’unité mobile, une voiture et quatre intervenants qui sillonnent chaque jour les squats et lieux cachés à la rencontre des UDI, des hommes et des femmes (moins de 10%) dont la plupart vivent dans une détresse et des conditions d’insalubrité inouïes.
« On a commencé par le quartier de M’sallah, au centre-ville, là où il y a la plus grande concentration d’injecteurs d’héroïne. Ils se piquaient devant les portes des habitants. Des enfants jouaient avec les seringues utilisées. Des jeunes filles les récupéraient pour faire [les tatouages au] henné. Alors on a travaillé avec les usagers sur leur comportement. »
Le travail de rue de l’AHSUD vise d’abord les UDI. « On distribue le matériel d’injection, à usage unique, donc stérile. On sensibilise les usagers sur les risques infectieux et non-infectieux tels que la tuberculose, le VIH et l’hépatite C. On montre comment se shooter à moindre risque, comment éviter les overdoses, quelle alternative en cas de manque de matériel. On les oriente vers les centres de santé. »
L’association travaille contre la stigmatisation en défendant les droits des UDI auprès des médecins, pharmaciens et policiers. Ses équipes de terrain font du porte à porte pour se présenter aux résidents du quartier. Ceux-ci, d’abord hostiles, s’ouvrent peu à peu à leurs arguments. « Parce que les consommateurs sont leurs fils et leurs filles », explique F. Bouzzitoun, et qu’on leur demande de choisir ce qui est le mieux pour eux. « Que préférez-vous : qu’ils consomment avec moins de risques, avec la possibilité qu’ils s’en sortent, ou les laisser exposés à l’hépatite C, au VIH, et transmettre ces maladies à toute la société ? »
Enfin, en 2010, le Maroc introduit à Tanger, Rabat et Casablanca le traitement de substitution à la méthadone, également pris en charge par le Fonds mondial et le ministère de la Santé. Si elle n’est pas une solution miracle, la méthadone aide à réduire les risques parce qu’elle ne nécessite pas d’injection. « Pendant 48 heures, l’utilisateur peut travailler, prendre une douche, manger, fonctionner comme un être humain normal. »
La lumière au bout du tunnel de l’héroïne
Aujourd’hui, de l’avis général, le travail de l’AHSUD, décrit dans le documentaire Ceux de M’Sallah, porte ses fruits. « Les gens interviewés disent que ce n’est plus comme avant, qu’il y a moins d’usagers, moins d’injecteurs, moins de vols et moins de criminalité qu’avant », constate fièrement F. Bouzzitoun.
Selon elle, presque tous les UDI dont s’occupe l’association utilisent les kits d’injection qui leur sont fournis (seringues, cuillères, filtres, tampons secs et alcoolisés, eau stérile) en échange de leurs seringues utilisées.
Parmi eux, 400 sont sous méthadone, administrée sous forme de sirop, pour faciliter l’observance du traitement et limiter la revente et les trafics.
Avec l’utilisation de kits stériles et la diminution du nombre d’injecteurs grâce à la méthadone, très peu d’usagers sont porteurs du VIH à Tanger, explique F. Bouzzitoun, alors que 80% ont été testés au moins une fois. « Depuis 2008, nous faisons le dépistage à l’association deux après-midis par semaine. Il y a moins d’un pour cent des UDI qui sont séropositifs. »
L’évolution des mentalités est également perceptible parmi ceux qui gravitent autour des UDI. « Actuellement quand un usager de drogue est arrêté, la police nous prévient automatiquement et nous demande de venir pour voir s’il a besoin de son traitement.»
Ces résultats ont encouragé le ministère de la Santé, avec l’aide du Fonds mondial, à étendre cette approche à d’autres centres-villes, à commencer par Tétouan en 2009 (en savoir plus). Mais pour autant, tout n’est pas réglé.
Et le programme méthadone, malgré d’excellents résultats (plus des deux-tiers des participants reprennent une vie active une fois stabilisés), reste largement insuffisant avec une liste d’attente de 900 personnes dans la seule ville de Tanger. « La plupart des UDI veulent s’en sortir », explique-t-on à l’association, mais toute la région manque de traitements, de personnel et de structure adaptée, comme le Centre Médico Psychologique qui jouxte l’AHSUD, fréquenté par 350 UDI sous méthadone et qui n’accepte plus de nouvelles demandes.
Tanger, laboratoire de la réduction des risques pour l’Afrique et le Moyen-Orient
Premier pays à introduire un programme de réduction des risques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et premier à introduire le traitement à la méthadone, le Maroc diffuse maintenant son expérience auprès d’autres programmes similaires par le biais du Centre de formation de l’AHSUD à Tanger.
*Lire cet article en anglais. Read this article in English.
Niger: Le mirage du bout du monde
Je suis couché sur le dos, à la belle étoile, fixant les cieux, étourdi, presque effrayé par l’immensité de la Voie Lactée. Je suis au bout du monde, comme j’en rêvais depuis longtemps, chez les Bororos, des éleveurs peuls qui vivent dans le sud du Sahara.
Mais je suis incapable d’en profiter. J’ai une tourista spectaculaire qui m’oblige à des va-et-vient incessants dans le désert, et les dernières braises du feu qu’ont allumé pour moi les nomades qui m’accueillent dans leur campement achèvent de se consumer. Le froid m’a réveillé. Un froid comme je n’en ai jamais connu, même dans mes pires hivers canadiens.
Je m’enroule du mieux que je peux dans la couverture qu’un ami nigérien m’a prêtée, en me souhaitant bonne chance, lorsque je lui ai annoncé que je partais seul pour plusieurs jours. J’ai enfilé tout ce que j’ai: un tee-shirt, une chemise et un pull. Mais rien n’y fait. Je suis allongé sur une natte posée sur le sable et je découvre avec effroi ce qui aurait dû être une évidence: le désert est un univers minéral qui, la nuit en décembre, ne retient pas la chaleur, même torride, de la journée.
J’ai la tête et les tempes qui gèlent. Sous la voute céleste, mes pensées entrent en collision avec une force inouïe, comme des galaxies qui s’entrechoquent, des supernovae qui explosent. Les Bororos dorment plus loin, quelque part derrière des buissons. J’ai peur de ne pas tenir jusqu’à l’aube mais, par fierté, je n’ose pas les réveiller.
Je suis prisonnier de ces pensées qui se bousculent de plus en plus vite et violemment. Que suis-je venu chercher ici, à une journée de route, trois jours de pistes et des heures de marche de la « civilisation » ? Quelle mouche m’a piqué pour m’exposer à de tels risques? Il n’y a pas de sortie de secours dans le désert. Impossible de faire marche arrière. Ce n’est plus un jeu.
Pour conjurer la panique que je sens monter, je déroule le fil qui m’a conduit jusqu’ici.
Le portrait d’une vache
Ces Peuls disposent dans leur langue de 150 adjectifs pour décrire la palette de nuances de la robe d’une vache (couleurs, formes, taille, nombre et emplacement des taches), ce qui en dit long sur l’importance du troupeau dans leur mode de vie et facilite les choses quand vient le temps de décrire et retracer un animal égaré.
Ces hommes et ces femmes sont les Eskimos du désert, des champions de la survie en milieu extrême. Les Bororos, aussi appelés Woodabés, sont célèbres pour le Gerewool, un grand événement annuel où les jeunes nomades sortent leurs plus jolies plumes et exposent la blancheur de leurs dents et de leurs yeux pour séduire les filles, un concours de beauté vital dans le désert, un contexte qui ne se prête pas trop aux rencontres fortuites (voir des photos).
Au milieu de nulle part
Arrivé au campement des nomades la veille après une marche interminable dans le désert, je mange de la boule, un mélange de lait et de mil pilé, au fond d’une calebasse où flotte une mouche. Un truc cru, vraiment pas terrible, que je me force à avaler, sous le regard attentif de mes oiseaux exotiques qui insistent pour que je me serve en premier, me fixant intensément et guettant mes réactions, dans un silence presque religieux.
En quelques minutes, je me transforme en usine à gaz. Littéralement. Je gonfle et sens la pression qui monte, comme une cocotte-minute prête à exploser. Je fais des efforts héroïques pour garder un air détendu mais je ne tiens plus en place. Et puis l’inévitable se produit. Priant pour que ce soit socialement acceptable chez mes nouveaux amis, comme chez ces Arabes pour qui il est de bon ton de roter après le repas, la main devant la bouche, en disant « Alhamdoulilah », je m’abandonne… et réalise que je n’ai pas été exaucé: mon lâcher prise est accueilli dans un éclat de rire général.
La situation a un potentiel comique. C’est net. Mais je n’ai pas le cœur à rire. J’ai fait des efforts inouïs pour trouver un nomade et une vache qui correspondent à mon idée de départ et atteindre ce bout du monde, une aventure comme je n’en ai jamais vécue. Juste au moment où je crois avoir atteint mon objectif, je reste figé derrière l’écran de mes pensées, cloué au sol par mes problèmes intestinaux. Et je m’interroge sur ce que je suis venu faire là.
Prendre de la distance
Comme d’autres, je pars pour me retrouver. C’est ce qui m’attire dans le voyage, un besoin que j’ai la chance d’assouvir par mon travail: prendre de la distance par rapport à ce que je crois connaître, faire le plein de sensations nouvelles, me confronter à d’autres regards, repousser mes limites, sortir de mes automatismes, me réconcilier avec qui je suis, tout ce que je mets en sourdine dans la répétition du quotidien, pour me sentir en vie. Mais comme pour tout le reste, je ne prends pas le temps de pleinement goûter ces rencontres et digérer ces expériences que j’avale avec gourmandise, comme un éternel insatiable.
J’ai découvert que, derrière les apparences, les personnages du film que je me suis fait me sont étrangement familiers: un père qui aime ses enfants et qui dort mal la nuit parce qu’il s’inquiète pour leur avenir, des gens qui aiment rire, chanter et manger, des enfants qui s’amusent de rien, des hommes qui se font beaux pour faire la cour, des femmes qui baissent les yeux devant un regard trop insistant, des jeunes rattrapés par la modernité, même dans ce coin perdu, curieux des nouvelles du monde qui leur parviennent par la magie des ondes courtes, des gens qui marchent la tête haute, conscients de leur valeur, plein de prévenance pour cet invité débarqué sans prévenir et manifestement démuni dans cet environnement hostile.
Maintenant que j’y suis, j’ai l’impression que les Bororos font partie de mon univers, que des années-lumière ne nous séparent pas, contrairement à ce que soupçonnais. Il m’a suffit d’échanger quelques phrases avec eux et gratter légèrement la surface pour me trouver des atomes crochus avec ces personnages de documentaires ethnologiques, ce que j’accueille avec un mélange de déception et un certain vertige devant l’évidence: nous appartenons à la même espèce.
L’autre bout du monde
La Voie Lactée serait si jolie si ce n’était de ma tuyauterie en furie, du cérébral qui me prend en otage, du froid insoutenable, de tout ce qui m’empêche de m’élever pour profiter de la beauté qui s’offre à moi, ici et maintenant.
Ma délivrance arrive avec la douceur des premiers rayons du soleil. Avec eux, je m’éveille à ce qui s’imposera comme une évidence.
Je suis allé chercher mon bout du monde aux antipodes chez des gens que j’espérais fondamentalement différents, comme si des extra-terrestres habitaient ma planète. Au fil du temps, j’ai poursuivi ce mirage aux quatre « coins » de la planète, dans les montagnes du Bhoutan, dans le désert du Rajasthan, dans les bidonvilles de Lagos… Mais au Niger, sans doute plus qu’ailleurs, les Bororos m’ont appris qu’il n’y a pas de bout du monde, ou alors qu’il me suit partout. Parce qu’il est en moi. Parce qu’il est en nous.
* Pour voir les photos en plein écran, démarrez le diaporama et cliquez dans le coin inférieur droit
Pour voir les photos en plein écran, démarrez le diaporama et cliquez dans le coin inférieur droit
G
Mauritania, the Global Fund and the discreet inclusion of the gay community in the HIV response
* This article was published in the Global Fund Observer (English – French), Aidspan‘s newsletter.
In a shaded courtyard of a non-descript building just on the outskirts of Nouakchott, a group of young men sits in comfortable repose. It’s a group with no official name, only the whispered identity of an MSM: a man who has sex with men. One by one they get up to sit on an overturned bucket and tell intimate details of their lives.
They are providing anonymized responses to two employees of the NGO SOS Pairs Educateurs as part of Mauritania’s first Integrated HIV Bio-Behavioral Surveillance (IBBS) survey since 2007.The data collected by the IBBS survey will help the national AIDS commission, SENLS, to develop its concept note for some $32 million allocated by the Global Fund to Mauritania under the new funding model (NFM). A first data collection in seven years will clarify the state of the disease and its response in the Islamic republic, both within the general population and those groups most exposed to the risks of infection: groups like commercial sex workers, prisoners, members of the security forces and truck drivers who travel the length of the West African corridor or across the northwestern deserts of the Sahel. Other high risk groups include economic migrants, sailors and the fishing industry.
But it’s the men who have sex with men who are the hardest to reach, even for the survey, in this very conservative society. « It’s impossible to say the word homosexual in public, » explains Fatimata Ball, who represents people living with HIV on the Mauritanian country coordinating mechanism (CCM). Ball is one of just two people in Mauritania who appear bare-faced when they talk about their HIV-positive status. With her head held high she daily battles discrimination on behalf of her fellow citizens living with the disease, and the taboos that complicate everything — especially anything to do with homosexuality. »They’re [considered] horrible people who we shouldn’t engage with — not even to shake their hands because for 40 days afterwards, your prayers will be worth nothing, » she says, shaking her head ruefully.
A ‘foreigner problem’
Officially, Mauritania is one of 11 countries worldwide where being gay is punishable by death. In reality, this penalty has not been applied against anyone since 1987. Conventional wisdom is that the country is not nearly as harsh in its perception of homosexuality as countries like Iran, or even southern neighbor Senegal. And Fatimata Ball is quick to say that religion — Mauritania practices a strict interpretation of Sunni Islam — doesn’t bear all the responsibility. « We’ve got the big religious leaders who are saying that, even if Islam condemns these practices, these are human beings who have the right to treatment, » she says. « But what they’re not doing is saying it publicly: not on the radio, or in the newspapers, or even during their sermons. They’re not saying it so people can hear, and so people aren’t frightened. »
Conventional wisdom is that the country is not nearly as harsh in its perception of homosexuality as countries like Iran, or even southern neighbor Senegal. And Fatimata Ball is quick to say that religion — Mauritania practices a strict interpretation of Sunni Islam — doesn’t bear all the responsibility. « We’ve got the big religious leaders who are saying that, even if Islam condemns these practices, these are human beings who have the right to treatment, » she says. « But what they’re not doing is saying it publicly: not on the radio, or in the newspapers, or even during their sermons. They’re not saying it so people can hear, and so people aren’t frightened. »
The silence is an advantage to the people working on the frontlines as well. « We don’t want to make noise around our work; our society doesn’t like too much buzz, » says Jibril Sy, president of SOS Pairs Educateurs, which has been working quietly in the gay community since 2001. « When we started our work, we knew that it would be a bad strategy to attack the law, » he says. « So we have really taken the angle of right to health, which works here. No matter who you are, even if you’re a stranger, Mauritanians believe you have a right to health. »
Most don’t, however, believe that HIV is a ‘Mauritanian thing’ but rather an uninvited import from neighboring countries, carried by people who fled Senegal or the Gambia to become refugees here. They think that those foreign elements are also responsible for the introduction of homosexuality into Mauritanian culture, reflecting their disharmony with the way things really are. According to Amadou Seye Ndiaye, himself of Senegalese origin, « if you behave normally, you should have no problems. But these new guys, they are bringing us trouble. They dress up in women’s clothings, they wear makeup, and they get married — like in Senegal. »
« There are a lot of men in Mauritania who have sex with other men, but we are very, very discreet. We can be the masters of ceremony at weddings and celebrations of birth but beyond that, we try not to attract attention, » says Ahmed. « But the Senegalese, they are very provocative, very daring. And it shows, and it shocks, and it causes a lot of people to revolt against them. »
Leaving the shadows behind, and being heard
« More and more we see gay men coming and asking for services from civil society, » says Aliou Diop of SOS Pairs Educateurs. What this means, according to Diop, is that if the state is allowing groups like his to respond, it’s that the state understands that the national response must accommodate all of the different needs. And the needs are growing, according to the preliminary results of the survey, which have yet to be made public, the HIV infection rate in the gay community is on the rise, likely to substantially exceed the 5% infection rate recorded in 2007.
Nothing proves the importance of reacting to an epidemic before it spreads beyond a concentrated population to the general population than a rise in infections, but Jibril Sy says there are very few, if any, activities being carried out across the country. This is due to the challenges that followed a damning Office of the Investigator General report from 2009. Suspension of the grant meant a loss of direction (learn more) and ultimately resulted in very little effort to target prevention activities to one of the communities that needed them most.
The new funding model (NFM) is providing Mauritania with a previously unanticipated opportunity: to wipe the slate clean and demonstrate its new capacity for risk management while also changing its strategy, and its approach, to HIV. This means a bigger ask — some $11 million — for innovative new programs that put key populations at the heart of the response. But even this is not without challenges because even condom distribution has to be done covertly (PDF – 600 Kb – p. 16) through people who volunteer to keep the products hidden in their homes.
Saving face or saving lives
For now, some short-term plans are in place, if only to establish what activities should be prioritized under the concept note using focus groups comprised of those who responded to the IBBS survey. This has been approved not only by the CCM but by the Fund’s own country team, which has emphasized the need for these proposals to come from the local context. If in Mauritania that means individuals, not formal or even public groups, that will work, as long as it is a participatory approach, the Global Fund Secretariat emphasized.
While being back in the good graces of the Global Fund will be critical to Mauritania’s HIV response, it is far from a magic bullet that will see an opening of Mauritanian society to homosexuality. « With or without funding, there is never going to be a legal recognition of the rights of men who have sex with men or sex workers, » says Fatimata Ball. « That’s non-negotiable in an Islamic country and no amount of money is going to change how Mauritanians feel about this. »
*Read this article in French. Lisez cet article en français.
Morocco’s open campaign against a secret epidemic starts with diagnosis
* This article was published in the Global Fund Observer (English – French), Aidspan‘s newsletter.
Objectively, Morocco’s HIV indicators paint a relatively reassuring picture of a country only grazed lightly by an epidemic that has had ruinous consequences elsewhere in Africa.
But delve a little deeper and the picture is not as rosy — because among those vulnerable groups, there is serious danger in the unknown. Three in four of Morocco’s most at-risk do not know their status, according to Dr Abdelaziz Ouassadan, coordinator of the diagnostics department at the Association for the Fight Against AIDS (ALCS). And while Morocco’s human rights record is improving (read Morocco’s quiet revolution over AIDS and human rights), stigma and discrimination continue — so finding them is like searching for a needle in a haystack.
« It’s really challenging, in the context of a 0.1% prevalence rate, to find 30,000 people, » he said during a recent visit. « Think about just how many tests you would have to do to find 100% of the infections. »
Since 1992, ALCS has been responsible for most of the diagnostic testing in Morocco. But of course it cannot be responsible for testing all 30 million people in Morocco alone and, despite all of the awareness campaigns of the last decade, many of which received Global Fund support, voluntary testing remains rare. A goal of reaching 80% of both men who have sex with men and sex workers seems far off.
Rather than abandoning the effort, however, the Moroccan government is putting more resources into achieving the diagnostic goals. A ‘know your status’ campaign is at the heart of the national strategic plan (in French) for 2012-2016, and includes an arsenal of activities, education and community mobilization led by grassroots organizations that know their clientele: the clandestine and vulnerable key populations. Taking diagnostics out of the hands of medical professionals and putting them into the hands of community health workers is another innovative component of a program currently in development.
Overcoming fear and ignorance
In Agadir, it is teams of women who are sent by ASCS into the red light zones where sex workers ply their trade. Equally, ALCS is doing its part to reach the truck drivers who form the largest part of the sex trade client base and those who are most likely to pass infections into the general population.
Work in this population has shown some modest result, said Dr Fatima Zahara, who heads the truck driver outreach program. The number of sex workers visited on average by a truck driver has declined from nine to six since 2007, and higher condom usage has been recorded. Truck drivers are also more inclined to get tested than they were before, she said, and they are taking fewer risks.
NGOs have had to be more innovative in their efforts to reach the Moroccan gay community, which remains in the shadows for fear of stigma and persecution.
« There are a lot of people we have not been able to reach, who use chat sites, » said Abdoullah Tif, who manages the web presence for ALCS. It was at Tif’s initiative, therefore, that ALCS has created a profile on PlanetRomeo, the most popular site for gay men in Morocco. « If you’re gay and can read and write, you’re on PlanetRomeo, » Tif said. ALCS now has an profile it uses to reach out to the more than 13,000 Moroccan users, to chat anonymously and share health information on topics such as HIV education, invitations for people to come to the ALCS office, and subtle encouragement for people to get tested and know their status.
« We’ve had a tough time finding doctors. Some of them have said very clearly that they will help us carry out diagnostic testing — but not with men who have sex with men, » she said. So how to bridge the gap between a medical community that is still stigmatizing homosexuality and a gay community staying firmly underground poses a critical challenge.
For ALCS, it means removing doctors from the equation. A new program about to get under way will provide training to community volunteers in diagnostics and counseling, so that people can work directly with their peers.
« In light of the need, the Health Ministry has approved the program, » said Younes Yatine, who leads the prevention campaigns for ALCS within the gay community. « Now it’s up to us to find the right volunteers, to provide the right kind of training, and to have the right start to the campaign. »
These community-led diagnostic programs should only be one among a number of different activities, cautioned Boutaina El Omari, who is the Global Fund focal point for the Ministry of Health « It’s not the one and only solution, » she said. « Studies have clearly shown that even with the tremendous effort being made by the NGOs, they will never reach everyone. »
*Read this article in French. Lisez cet article en français.
Syrie: L’avocat du diable
J’aime faire l’avocat du diable, défendre tout et son contraire, des idées auxquelles je ne crois pas toujours, pour tester celles des autres et construire les miennes. C’est un luxe avec lequel j’ai grandi au Canada, un trait de personnalité qui ne s’est pas arrangé avec mes études de droit, mais un jeu risqué en territoire miné, au sens propre et figuré, comme dans la ville-fantôme de Quneitra, en février 1988.
Une ville entière méthodiquement dynamitée et aplatie au bulldozer pour s’assurer que les ennemis syriens ne reviendraient pas s’installer trop près des hauteurs du plateau qui, à mille mètres, surplombe le nord-est d’Israël et expose les colonies juives implantées plus bas. Des immeubles éventrés, des débris partout et des murs criblés de milliers d’impacts de gros calibres, symboles de la haine viscérale que se vouent les Israéliens et les Syriens.
Des immeubles éventrés, des débris partout et des murs criblés de milliers d’impacts de gros calibres, symboles de la haine viscérale que se vouent les Israéliens et les Syriens.
Depuis près de 40 ans, rien n’a changé ici sauf les panneaux d’affichage ajoutés un peu partout pour faire de Quneitra un musée à ciel ouvert de la barbarie israélienne. Comme dans cet hôpital « détruit par les sionistes » que je visite avec des compagnons de voyage suédois et allemand.
Pour visiter Quneitra, il nous a suffi de nous présenter au Ministère de la Défense à Damas qui a mis gratuitement à notre disposition une voiture avec chauffeur, un responsable de la propagande et le casse-croûte. Un traitement royal pour trois jeunes voyageurs sans influence et sans le sou qui donne une idée de l’importance que le régime accorde à ce type de « relations publiques ». Nous passons quelques heures dans les ruines de la ville délimitée par des barbelés et un champ de mines qui s’étend à perte de vue à l’ouest, au-delà de la zone démilitarisée maintenant occupée par les Casques Bleus canadiens de la FNUOD. Et puis nous rentrons.
J’avais bien pris quelques résolutions avant mon départ pour le Moyen-Orient, où je partais sac au dos pour six mois. Règle numéro un: ne pas dire que je suis journaliste. Je travaille depuis quelques années pour Radio-Canada et j’ai l’intention de faire des piges pour un quotidien montréalais mais je me présente toujours comme un avocat, ce qui n’est pas faux puisque je viens de terminer mes études et d’être assermenté. Règle numéro deux: éviter toute discussion politique, un conseil de simple bon sens, particulièrement dans une dictature comme la Syrie, dirigée d’une main de fer par la minorité alaouite (20% de la population), une branche de l’Islam plus près des chiites que des sunnites (Wikipedia), ce qui explique ses alliances avec l’Iran et le Hezbollah libanais.
Mais dans la voiture qui nous ramène à Damas, nous devons endurer le long monologue du responsable du discours officiel, un capitaine très sûr de lui, à l’accent exagérément british et au sourire figé, comme s’il posait pour une publicité de dentifrice. Devant les libertés qu’il prend avec l’histoire et les énormités qu’il nous sert, je pose quelques questions sur un ton naïf et je fais quelques observations qui finissent par l’agacer. « Vous savez, vous avez vraiment l’air d’un avocat!« , me dit mon Warren Beatty à galons avec un sourire de plus en plus inquiétant. Je sens la menace mais je m’efforce de lui répondre sur le même ton: « Vraiment? De quoi a l’air un avocat?« . « Vous avez l’air étrange… » me dit-il avec le sourire qui se décompose rapidement. « Je ferais très attention si j’étais vous. Nous savons où vous logez et nous avons votre numéro de passeport. »
Peut-on être plus clair? Le soir même, vers 22h30, à une heure où Damas, comme Quneitra, prend des allures de ville-fantôme, je suis expulsé manu militari et sans explication de la seule auberge de jeunesse de la capitale et je me retrouve à la rue, seul, sous une pluie fine. Par chance, l’ami suédois avec qui j’ai visité Quneitra voyage dans une camionnette où je pourrai passer la nuit.
Au royaume de la terreur
Je revois la panique que je provoque bien malgré moi chez ces étudiants en médecine avec qui je me suis lié d’amitié, qui m’accompagnent sur un trottoir désert de la ville côtière de Lataquié et qui balaient nerveusement du regard les alentours, comme des bêtes traquées, lorsque j’ose prononcer, du bout des lèvres, le nom d’El Assad.
Je revis cet étrange sentiment d’écrasement, presque de nausée, devant la photo omniprésente du dictateur, affichée dans la moindre petite boutique et jusque dans l’intimité des foyers. Non pas, bien sûr, comme un signe d’allégeance mais parce que tout le monde sait que négliger cet élément de décoration serait suicidaire.
Je ressens cette poussée d’adrénaline devant des piles de kalashnikovs que j’aperçois du coin de l’oeil sur le siège arrière de voitures banalisées des services secrets quand j’ose m’aventurer, sans ralentir le pas, dans la rue où habite El Assad à Damas, sous l’oeil attentif de policiers en civil, postés tous les cinquante mètres, et qui ne me quittent pas du regard.
postés tous les cinquante mètres, et qui ne me quittent pas du regard.
Je sens la profonde méfiance des habitants de Hama, ville apparement sans histoire, célèbre pour ses roues à aubes géantes et pour le massacre de 20,000 personnes en février 1982, en réponse à un soulèvement sunnite. Une ville où je fais du tourisme, quelques années à peine après que des quartiers entiers aient été rasés et aplatis au rouleau-compresseur, tout comme ce qu’El Assad reproche aux Juifs d’avoir fait à Quneitra (sur ce sujet, une chronique du New York Times, The New Hama Rules).
Ce sont ces images que je garde de la Syrie et qui me reviennent parfois, particulièrement en période d’élections, chez moi, quand on publie les scores toujours impressionnants de ceux qui ne votent pas ou qui votent « blanc », par désillusion ou par paresse. Quels que soient les résultats, j’ai toujours l’impression d’être gagnant quand je resonge à ces quelques amis croisés en Syrie, des gens extrêmement curieux de ce jeune voyageur apparemment inconscient et un peu naïf, comme venu d’une autre planète, mais libre de sa parole et de ses pensées, un idéal encore inatteignable au royaume de la terreur.
Sida et droits humains: la révolution tranquille du Maroc
*Cet article a été publié en français et en anglais dans
l’Observateur du Fonds Mondial, la lettre d’information d’Aidspan
En juillet 2014, dans une salle de réunion de Rabat, assise aux côtés de représentants d’organisations internationales, de grandes ONG et de ministères, dont ceux des Affaires islamiques et de l’Administration pénitentiaire, une jeune Marocaine a prononcé des mots qui résonnent encore aux oreilles de Boutaina Selma El Omari, Coordinatrice de l’Unité de Gestion du Programme d’appui du Fonds mondial au ministère de la Santé. « Elle s’est présentée en arabe pour dire ‘Je représente les professionnelles du sexe’. C’est encore plus péjoratif en arabe et elle a osé le dire ! »
A la suite de celle-ci, deux autres participants ont brisé le mur du silence: ‘Je représente les HSH’ (hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes) … ‘Je représente les UDI’ (usagers de drogues injectables). Au total, cinq sièges sur un total de 33 sont désormais réservés aux représentants des groupes les plus exposés aux risques d’infection par VIH dans le nouveau Comité de Coordination du Maroc (CCM), l’instance décisionnelle qui supervise les demandes de financement du pays auprès du Fonds mondial et assure le suivi des programmes sida et tuberculose.
C’est du jamais-vu au Maroc et dans la majeure partie du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, le résultat d’un long travail de préparation, explique Boutaina El Omari, et d’un processus de sélection mené indépendamment, sous la supervision d’un notaire. « Comme il n’y a pas d’association de ces groupes-là parce que c’est illégal [l’homosexualité, la prostitution, l’usage de drogues], on a dû passer par les ONG qui collaborent avec eux. Toutes les ONG thématiques ont été impliquées. »
Le Fonds mondial, le bon sens et le Roi
Au Maroc, plusieurs facteurs favorisent une meilleure reconnaissance des droits de l’Homme dans la lutte contre le VIH, comme les droits à la vie, à la santé et au respect de la dignité humaine et de la vie privée.
« Le ministère de la Santé a, depuis le départ de l’épidémie, compris qu’il faut travailler auprès de ces groupes », confirme Boutaina El Omari. Et pour une raison bien simple: les deux tiers des nouvelles infections au Maroc se concentrent dans ces populations clés (HSH, UDI, PS, leurs partenaires et clients). Si l’épidémie au sein de ces groupes n’est pas contenue (environ 5% de prévalence chez les HSH, 8% parmi les PS et plus de 10% pour les UDI), elle menace la population générale, dont la séroprévalence reste faible pour l’instant, à moins de 1%.
Un important cadre législatif a été mis en place ces dernières années. Il inclut les droits et libertés reconnus dans la Constitution marocaine de 2011, le Plan Stratégique National de lutte contre le Sida 2012-2016 et, pour accompagner ce plan, une nouvelle Stratégie nationale sur les droits humains et le VIH/sida qui vise l’élimination de toute discrimination à l’encontre des personnes vulnérables.
Avant même le renouvellement du CCM, l’adoption de nouvelles lois ou le soutien du Fonds mondial, le véritable point de départ, selon M. Belekbir, a été l’arrivée sur le trône de S.M. Mohamed VI et son engagement public contre le sida. « On est encouragé par notre leader parce que c’est le chef suprême des religieux et des croyants. Nous, on a cet engagement religieux, politique, social », explique-t-il, à tel point que « tout le monde s’intéresse au modèle du Maroc » et qu’il est régulièrement consulté par les autres pays de la région pour partager son expérience. « On essaie de ne pas trop se comparer, confirme B. El Omari, mais quand on est dans les conférences internationales, on sait qu’on est à des années-lumière. On sent même parfois que les gens croient qu’on exagère. »
Premiers pas dans les souliers du pouvoir
« J’ai été un peu choquée au début de ce que je voyais dans le regard des autres membres du CCM, que ce soit de l’empathie, de la pitié ou de l’intolérance, se rappelle celle qui, en juillet, a pris la parole au nom des professionnelles du sexe. Mais en même temps, je suis encouragée par le poids de ma responsabilité. Les gens que je représente sont plus une motivation qu’un frein. »
Tous n’ont pas encore la même aisance, reconnaît le porte-parole des personnes qui vivent avec le VIH : « Parfois, quand on veut prendre la parole devant des représentants de grands secteurs, c’est un peu intimidant. Vous avez des idées, mais quand vous voulez parler, tout se bouscule ». Mais ils ont d’autres atouts essentiels, lui répond le cotitulaire du siège des UDI, tels que leurs idées et leur expérience sur la discrimination, la réduction des risques et la sensibilisation au dépistage: « Eux connaissent les mots techniques. Ce sont des docteurs, ce sont des professeurs, mais ils ne sont pas sur le terrain ».
Le CCM : une pépinière pour les droits humains
Malgré les avancées, beaucoup reste à accomplir en matière de droits humains et de VIH au Maroc. Pour preuve, les nouveaux membres qui défendent les intérêts des populations clés au CCM ont, dans le cadre de ce reportage, demandé l’anonymat et la discrétion au sujet des groupes qu’ils représentent.
Maintenant qu’un cadre législatif est mis en place et que le ministère de la Santé montre la voie, la police et les différents ministères concernés par la discrimination contre les personnes séropositives (Justice, Affaires sociales, Administration pénitentiaire) doivent lui emboîter le pas, ce qui n’a rien d’une évidence. « La société accepte assez bien, explique le représentant des UDI. Mais le gouvernement et tout ce qui est officiel ne doit pas donner l’apparence d’une trop grande tolérance, par peur de choquer. »
L’idée, rappelle Boutaina El Omari, de l’Unité de Gestion du Programme d’appui du Fonds mondial, n’est pas de précipiter une évolution imposée par des bailleurs de fonds qui ne tienne pas compte du contexte local, ou encore de forcer l’abrogation des lois qui pénalisent l’usage de drogues, la prostitution et les relations sexuelles entre adultes consentants. L’objectif est à la fois plus modeste et plus urgent face aux risques que l’épidémie de VIH, pour l’instant concentrée parmi ces groupes vulnérables mais en progression, fait poser à la population toute entière : « Tout ce qu’on veut, c’est que la personne qui vit avec le VIH, qu’elle soit usager de drogue, PS ou HSH, soit reconnue comme une Marocaine ou un Marocain qui a droit à la santé ».
*Lire l’article en anglais. Read this article in English.
Inde: Partir en fumée
Cette photo est un gag, ma publicité Camel à l’époque où, pour certains, il était encore cool de fumer. Une mise en scène pour reproduire ces campagnes des marchands de tabac faisant croire que fumer est bon pour l’aventurier qui sommeille en chaque homme, que c’est un symbole de virilité, synonyme de grands espaces, d’air pur (sic) et donc de bonne santé.
C’était en mai 1988, avant que les bandeaux « Fumer tue » et les images de dents ou de poumons noircis par la nicotine viennent défigurer les jolis paquets et briser le rêve.
Elle a été prise au cours d’une randonnée à dos de chameau dans le désert du Rajasthan, près de la ville magique de Jaisalmer, dans un temple hindou abandonné d’un petit village apparemment vide où je m’étais réfugié à 10:00 am, à l’abri des 50 degrés qu’il faisait à la mi-journée. Un jour où j’ai cru mourir de soif, déshydraté pour la première fois de ma vie, incapable d’épancher ma soif avec mes deux malheureuses bouteilles d’eau minérale, sentant monter la panique, obligé de boire l’eau saumâtre du puits des chameliers. L’aventure, je vous disais…
J’ai souvent repensé à cette photo. Parce qu’elle a bien fait rigoler les amis mais aussi et surtout, à cause d’un détail du décor dans lequel elle a été prise. En zoomant sur l’arrière-plan, on aperçoit des empreintes de mains rouges derrière mon figurant exotique et moi, des motifs qui rappellent les mains au pochoir des grottes préhistoriques.
Le chamelier, qui parlait très peu anglais, m’avait vaguement fait comprendre qu’il s’agissait d’un rituel de veuves. J’étais reparti vers de nouvelles aventures, content de mon effet. Je n’en savais pas plus. Jusqu’à ce que je lance récemment une recherche avec widow india (veuve inde) sur Internet et que je découvre le « sati ».
Le feu sacré
Le sati (« femme fidèle » en sanskrit) est une vieille coutume hindoue qui encourage les veuves à se placer dans le bûcher funéraire de leur époux pour le suivre dans la mort, une pratique formellement interdite par le pouvoir colonial britannique dès 1830 mais qui a connu un regain de popularité après l’indépendance de l’Inde en 1947, avec 40 cas rapportés dans quatre états du nord de l’Inde, dont 30 pour le seul Rajasthan.
Quelques cas se sont reproduits plus récemment. Chaque fois, la candidate au sati semble suivre un même rituel. Comme au jour de son mariage, elle se purifie en se lavant, enfile un sari rouge et ses bracelets d’ivoire. Elle se maquille les mains au henné et imprime la marque de sa main sur un mur chez elle ou au temple. Elle monte sur le bûcher et s’y assoit, tenant la tête de son mari sur ses genoux et une copie de la Bhagavad-Gītā, la partie centrale du Mahābhārata, le livre sacré des hindous. Et puis elle donne le signal d’allumer le feu.
Vivre dans la honte ou mourir dans l’honneur
Comment une femme peut-elle en venir à s’immoler vivante, en présence parfois de centaines, voire de milliers de badauds qui ne font rien pour l’en empêcher? S’agit-il vraiment d’actes volontaires ou y sont-elles forcées à cause du poids de la tradition et de la pression de l’entourage, pour des raisons d’héritage ou de superstitions?
Pour la vaste majorité des Indiens, le sati est une histoire d’horreur. La presse nationale, des groupes de lutte pour les droits des femmes et l’opinion publique avaient réagi très fortement au sati de Roop Kanwar, condamnant « un acte barbare et primitif », ce qui avait poussé le gouvernement à adopter une loi contre le sati assortie de lourdes peines de prison pour ceux qui l’encourageraient. Mais pour certains Rajputs, les habitants du Rajasthan, le sati reste une histoire d’amour, un acte surnaturel, la conséquence logique d’un amour si profond que les âmes ne souhaitent pas être séparées.
La croyance en la réincarnation est une clé essentielle pour comprendre le sati. Comme pour les kamikazes musulmans à qui l’on promet que 70 vierges les attendent au paradis, ces femmes croient que leur sacrifice portera bonheur à sept générations de descendants de leurs famille et belle-famille, ainsi qu’à leur village, qu’elles ne souffriront pas et qu’elles seront vénérées comme des saintes. En prouvant la pureté de leur amour pour leur mari, elles veulent l’aider à monter au ciel et faciliter sa réincarnation. En récompense de leur courage, elles espèrent renaître dans le corps d’un homme « supérieur » et non dans celui d’une femme de caste inférieure.
En récompense de leur courage, elles espèrent renaître dans le corps d’un homme « supérieur » et non dans celui d’une femme de caste inférieure.
Mais la cause principale de la renaissance de cette tradition est probablement liée au sort des veuves en Inde. Dans une culture où la femme est entièrement dévouée au bien-être de son mari, les veuves sont perçues comme portant malheur. Parfois rejetées, humiliées, insultées, agressées par leurs belles-familles, ces femmes sont condamnées à vivre une vie d’ascète et peuvent n’avoir d’autre solution que de joindre un ashram de veuves (voir un article avec photos sur ce sujet). Face à l’éventualité de vivre dans la honte, certaines préféreraient la mort dans l’honneur.
Déesses rouges, veuves blanches et cigarettes brunes
Le décor de ma parodie de publicité marque l’endroit où des veuves ont laissé l’empreinte de leurs mains, comme une marque de dévotion à leurs maris qu’elles s’apprêtaient à rejoindre dans la mort. Qui étaient-elles? Quand ont-elles vécu? Sont-elles vraiment toutes mortes? En se jetant sur le bûcher funéraire de leur mari? Certaines se sont-elles pendues, comme semble le suggérer le dessin qui apparaît juste au-dessus de ma tête, sur la droite?
Combien de fois suis-je ainsi passé complètement à côté de la réalité des pays que je visitais, inconscient de ce que les gens que je rencontrais vivaient et des choses que je croyais voir, plus occupé à perpétuer mes illusions qu’à être réceptif à ce qui m’entourait? Si j’avais su qu’à cet endroit, à cause d’une tradition archaïque, la vie de femmes innocentes était partie en fumée, je serais certainement allé répandre la mienne un peu plus loin.
Note d’espoir: le sati reste extrêmement rare, les Indiens prennent la lutte contre ces coutumes rétrogrades très au sérieux et de nombreuses initiatives indiennes et étrangères s’attachent à améliorer le sort des veuves. Comme celle-ci, illustrée par Beesamma, une veuve mère de deux enfants qu’elle peut élever sans soutien familial grâce à un programme de micro-crédit d’une ONG canadienne.
Angola: Le choix de Sophie
Ils sont 200 ou 300 enfants dans le bâtiment désaffecté mais on peut entendre une mouche voler. Un silence étrange, presque assourdissant, à la limite du supportable. Des enfants bien sages parce qu’ils meurent de faim. Ils n’ont plus la force ni de crier, ni de pleurer, à peine celle d’avaler lentement le bol de bouillie de maïs et de haricots qu’ils attendent depuis si longtemps.
L’image de ces enfants, presque résignés à mourir alors qu’ils viennent à peine de faire leurs premiers pas dans la vie, m’a longtemps hanté.
Je suis à Ganda, en Angola, à la veille de Noël en 1994, dans un ancien garage converti en Centre nutritionnel par le Comité International de la Croix-Rouge (CICR). Cette petite ville presque entièrement détruite est prise au piège d’un champ de mines qui l’encercle complètement et qui empêche les gens de cultiver leurs champs, d’où cette famine entièrement provoquée par l’homme, dans une région bien verte où tout pousse.
Le Centre nutritionnel est une cuisine d’urgence où l’on nourrit à petites doses et jusqu’à huit fois par jour les enfants les plus menacés de mort. Ici, on essaie de leur faire quitter un seuil critique, le point de non-retour qui sépare ceux qui sont encore assez forts pour s’en sortir de ceux pour qui on ne peut plus rien.
Pour prendre cette décision, la jeune femme sur la photo, une infirmière portugaise employée par le CICR, mesure la circonférence du bras du garçon pour estimer sa masse graisseuse et, en fonction de la taille de l’enfant, évaluer son niveau de malnutrition. Dans le cas présent, il est trop tard.
Le soir après avoir pris cette photo, j’ai longuement discuté avec Étienne Fox, un autre délégué du CICR en poste à Ganda. Après une bière ou deux, il a accepté que je démarre mon enregistreur pour qu’il me raconte les circonstances dans lesquelles il doit faire ce tri entre les enfants que les mères lui présentent, ce qui rappelle le dilemme du personnage central du film et roman « Le Choix de Sophie », une survivante d’un camp de concentration nazi forcée de choisir lequel de ses deux enfants envoyer à la chambre à gaz.
Dans l’entretien qui suit, Étienne semble parler de ce droit de vie et de mort avec détachement. Il se dit d’ailleurs un peu cynique de nature. C’est sans doute sa façon à lui de se protéger contre l’absurdité apparente de cette situation.
***Ecoutez l’interview d’Etienne Fox, délégué du CICR (ou lisez sa retranscription plus bas):
[soundcloud url= »https://api.soundcloud.com/tracks/189100098″ params= »color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false » width= »100% » height= »166″ iframe= »true » /]
E. Fox. En situation de famine, quand on fait une sélection d’enfants avec un système qui s’appelle « quack stick » qui est le périmètre brachial par rapport à la taille de l’enfant, c’est vrai qu’on fait un petit peu le ‘Choix de Sophie’. C’est un droit de vie et de mort par rapport à la personne que tu sélectionnes pour rentrer dans une cuisine. Tu sais que tu ne peux pas sélectionner tout le monde. Donc automatiquement tu prends les gens qui te semblent le plus aptes à vivre, pas forcément ceux qui sont le plus mal.
C’est une des expériences que j’ai trouvées les plus difficiles. Là tu fais une sélection personnelle et c’est toi qui décides qui va vivre et qui va mourir. On a ouvert à Ganda des cuisines pour recueillir 7000 enfants. Sur les sélections, il y avait à peu près 2000 enfants qui étaient en-dessous de 75%, même de 60% de poids normal. Et on ne pouvait en prendre que 500 par cuisine.
C’est très pénible, la première sélection. Et après, c’est comme tout, on s’habitue. On devient beaucoup plus dur. On devient beaucoup plus juste dans le but à atteindre, c’est-à-dire qu’on élimine systématiquement les enfants qui n’ont aucune chance de survivre pour ne pas doubler la mortalité. Si on met 30 enfants qui vont mourir dans une cuisine, on n’en prend pas 30 autres qui auraient eu peut-être une chance, et qui, eux, vont s’affaiblir pendant que les 30 premiers meurent. Donc en fait c’est complètement contre-productif : on a 60 personnes qui meurent au lieu de pouvoir en sauver 30.
E. Fox. Au début, oui, sûrement. Parce qu’on s’apitoie, on a tous nos réflexes occidentaux. On voit un petit enfant qui est une boule d’os, on va le mettre dans une cuisine… On le réalise très vite parce que le lendemain ils sont d’habitude morts. Donc on se dit : « il aurait mieux valu donner une chance à ceux qui vont survivre ». Ça c’est très africain aussi. Les parents comprennent très mal qu’on mette des enfants qui pour eux de toute façon vont mourir… Alors ils nous poussent plutôt à mettre ceux qui vont relativement bien pour qu’ils aient une chance de survivre.
E. Fox. Très bien. Parce que si je n’avais pas fait un minimum d’erreurs, les autres… Ce qu’il faut faire, c’est les réaliser, assez vite dans ce style de choses. Mais c’est très difficile. J’ai vu des médecins qui étaient pourtant habitués depuis longtemps à ce style de situations, qui prenaient systématiquement des enfants qui mouraient dans la semaine qui venait. Pourquoi ? Parce que c’est très difficile de dire à une mère qui te tend un enfant : « C’est pas possible ». Pourquoi ce n’est pas possible ? Parce que toi, t’as décidé que médicalement c’est fini, il ne récupérera jamais.
Même dans des soins intensifs européens, ces enfants n’auraient aucune chance. Ils sont nés dans des situations de famine ou de malnutrition chronique, et ça fait parfois des mois qu’ils mangent de l’herbe, qu’ils mangent des papayes vertes, qu’ils n’ont aucun accès à ce qu’il faudrait, en plus en période de croissance. Donc déjà au niveau physique ils sont très mal et au niveau cerveau, ils sont foutus.
E. Fox. Les enfants qui vont très mal sont extrêmement sages. Les enfants ne jouent plus quand ils commencent à aller mal. Les enfants savent très vite quand ça ndee va plus du tout, quand ils vont mourir. Donc ils acceptent le fait beaucoup plus que nous qui trouvons ça tout-à-fait injuste. Pour eux… ils en ont tellement vécu que… ils trouvent très bien si on leur apporte une aide, mais c’est un petit peu extra-terrestre comme aide. Donc ils l’acceptent assez bien.
E. Fox. Dans leur regard, dans leur attitude. On leur met des bracelets à partir du moment où ils sont sélectionnés, alors ils tendent tous le bras. Quand on ne lui met pas de bracelet autour du bras, l’enfant te regarde un moment et puis il part. Il n’y a pas de protestation, les enfants s’accrochent pas pour essayer de rentrer. Ils savent que c’est une loterie. Ils ont vécu dans cette loterie toute leur vie d’enfant. On vieillit très vite en Afrique. Ils l’acceptent parce qu’ils n’ont pas le choix.
E. Fox. Ça c’est un problème de déshumanisation des victimes. Une victime de type Auschwitz, ce n’est plus un enfant, ce n’est plus un adulte, c’est un paquet d’os qui ne réagit plus. Il a perdu toute personnalité. C’est la surmisère. C’est quelqu’un qui est très souvent habillé en loques, s’il est encore habillé, qui n’en peut plus, qui va s’effondrer psychologiquement.
On voit souvent des enfants qui repiquent un petit peu et ensuite qui deviennent complètement autistes quand ils réalisent ce qui leur arrive, et qui se laissent mourir. C’est un des problèmes qu’on a. Il y a beaucoup d’enfants qui simplement arrêtent de manger. Au bout d’un moment ils sont dans une telle misère psychologique… Beaucoup d’orphelins sont abandonnés dans les champs parce que leurs parents ont été tués ou parce qu’ils ont fui, ils n’ont pas pu suivre ou ils ont été laissés souvent avec une grand-mère ou un vieux qui est resté au village et ces gens sont morts de faim ou de différentes autres causes. Alors ils s’enferment.
On voit très vite quand les gens baissent les bras psychologiquement. Tout d’un coup ils arrêtent de manger et ils meurent en deux-trois jours. Ça c’est un des cas qu’on rencontre énormément. Les enfants sont plus fragiles par rapport à ça. Ils sont très durs au niveau de la survie, il y a un instinct incroyable. Mais tant qu’il n’y a pas trop de misère psychologique. S’il se sent abandonné, un enfant va se laisser mourir.
Coucou Sciences Po
QM/KBmn;br
BRSD;n brs. rsBD
srB;, b C
C